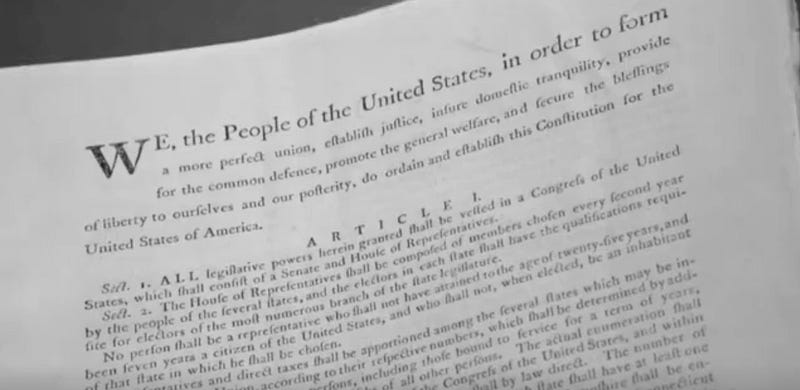Moore v. Harper : la démocratie étatsunienne en danger ?
En devant se prononcer sur une affaire de découpage électoral en Caroline du Nord, la Cour suprême des États-Unis a éveillé de nombreuses…
En devant se prononcer sur une affaire de découpage électoral en Caroline du Nord, la Cour suprême des États-Unis a éveillé de nombreuses craintes quant à l’avenir de la démocratie américaine.
« La plus grande menace pour la démocratie américaine depuis le 6 Janvier », « La théorie antidémocratique approuvée par les conservateurs de la Cour suprême ». Les titres apocalytiques ne manquent pas dans la presse d’outre-Atlantique. Le 7 décembre, les neuf juges de la Cour suprême des États-Unis entendront l’affaire Moore v. Harper. Au centre de ladite affaire, une histoire de gerrymandering partisan. Le terme, mot-valise composé de Gerry (du nom d’Elbridge Gerry, gouverneur du Massachusetts de 1810 à 1812) et de salamander (salamandre), désigne une opération de découpage électorale donnant naissance à des circonscriptions aux formes pour le moins originales et destinées à favoriser un parti.
L’an dernier, le pouvoir législatif de Caroline du Nord a conçu une nouvelle carte électorale, composée de 14 circonscriptions congressionnelles. Au vu du découpage qui a été opéré, cette carte garantirait 10 sièges à la Chambre des Représentants pour le Parti républicain contre seulement 4 pour le Parti démocrate. En conséquence, l’affaire a été portée en justice, la partie plaignante estimant que ce découpage est partisan et par conséquent contraire à la Constitution de cet État. L’affaire, alors intitulée Harper v. Hall, s’est achevée devant la Cour suprême de Caroline du Nord, laquelle a invalidé la carte et renvoyé l’affaire devant la cour de district, qui a nommé 3 experts en vue de concevoir une nouvelle carte électorale.
Le 17 mars 2022, le Speaker de la Chambre des Représentants de Caroline du Nord, Timothy K. Moore, a adressé une requête (un « writ of certiorari ») à la Cour suprême fédérale, qui a accepté de se saisir de l’affaire. La question à laquelle devront répondre les neuf juges implique l’« Independent State Legislature Theory » (théorie de la législature d’État indépendante, ISLT), une théorie juridique dont les répercussions pourraient être majeures pour l’avenir de la démocratie étatsunienne si elle venait à être adoptée par la Cour suprême.
Des législatures d’États au pouvoir plénier et exclusif
Pour bien comprendre l’ISLT, il faut revenir (très brièvement) sur le fondement du système politique des États-Unis : le fédéralisme. Les États-Unis sont actuellement composés de 50 États. Chacun de ces États dispose de son propre pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir législatif fédéral (composé de deux chambres : la Chambre des Représentants et le Sénat), dont les prérogatives sont limitées et circonscrites par l’Article I, Section 8 de la Constitution fédérale et le 10e amendement, dépend d’élections dont les règles sont définies par chacun de ces 50 États, bien que le Congrès fédéral puisse lui-même mettre en œuvre certaines règles. Il s’agit de l’« Elections Clause ».
Le principe central de l’ISLT repose sur une lecture stricte de l’Elections Clause. Pour les tenants de l’ISLT, la législation mise en œuvre par le pouvoir législatif des États dans le cadre d’élections fédérales ne saurait être remise en cause par le pouvoir judiciaire desdits États : dès lors, quand même bien une Constitution d’État prohibe le gerrymandering partisan, les cours de justice étatiques ne sauraient agir.
Pour nombre de juristes, à l’instar de la professeure de droit Carolyn Shapiro (Chicago-Kent College of Law), l’ISLT a reçu un écho favorable de la part de l’aile conservatrice de la Cour suprême. Dans un article intitulé The Independent State Legislature Theory, Federal Courts, and State Law, elle souligne que cette théorie a pris une ampleur sans précédent en 2020, alors que les États fédérés adaptaient leurs codes électoraux à la pandémie de Covid-19 : les cas du Wisconsin et de Pennsylvanie, où les échéances pour l’envoi de bulletins de vote par correspondance ont été repoussées par voie judiciaire, ont donné lieu à des réactions très vives de certains juges de la plus haute juridiction du pays, à l’instar de celle du juge Alito dans Boockvar II : « Les dispositions de la Constitution fédérale qui confèrent aux législatures des États, et non aux tribunaux des États, le pouvoir d’établir des règles régissant les élections fédérales seraient dénuées de sens si un tribunal d’État pouvait annuler les règles adoptées par la législature en prétendant simplement qu’une disposition constitutionnelle de l’État donne aux tribunaux le pouvoir d’établir les règles qu’il juge appropriées pour la conduite d’une élection juste. »
Pour autant, aussi acerbes puissent être certaines opinions, elles semblent moins relever d’une adhésion à l’ISLT que d’une volonté de rejeter ce qui perçu par les juges comme une forme d’« activisme judiciaire » usurpant les prérogatives du pouvoir législatif : tant la jurisprudence récente que la philosophie judiciaire des magistrats plaident en faveur d’un rejet de cette théorie.
L’Independent State Legislature est une théorie peu sérieuse
Dans un mémoire en amis de la Cour, les constitutionnalistes Akhil Amar, Vikram Amar et Steven G. Calabresi présentent l’ISLT comme une théorie fallacieuse. Originalistes comme le sont les juges Thomas, Gorsuch et Barrett — partisans d’une interprétation de la Constitution selon le sens qu’elle avait au moment de sa ratification — , les trois juristes affirment d’emblée que l’ISLT ne saurait être prise au sérieux : « Ce point de départ fondamental — à savoir que les législatures des États sont des créatures des constitutions des États, des créatures dont l’existence et la forme mêmes découlent des constitutions des États — permet de mettre en échec l’ISLT ». En outre, ils rappellent que le terme « legislature » ne doit pas être interprété comme désignant le seul pouvoir législatif mais comme le « système législatif » dans son ensemble.
Enfin, une analyse rapide de la jurisprudence récente suffit à dissiper les doutes sur l’adhésion de certains juges à l’ISLT. En 2019, la Cour suprême rendait à 5 contre 4 l’arrêt Rucho v. Common Cause. Comme le notent judicieusement les frères Amar et Steven Calabresi, les juges Gorsuch, Alito, Thomas et Kavanaugh se sont joints à l’opinion rédigée par le Chief Justice John Roberts. Affirmant que le gerrymandering partisan ne constituait pas une « question justiciable » pour les cours fédérales, il affirmait cependant que « [l]es dispositions des lois et des constitutions des États peuvent fournir des normes et des orientations que les tribunaux étatiques peuvent appliquer » : il devient par conséquent difficile d’imaginer les juges renverser leur propre précédent en l’espace de seulement quatre ans. En effet, bien qu’elle ne soit pas contraignante pour la Cour suprême, la règle du précédent (appelée stare decisis) est « une part essentielle du système juridique américain, nécessaire pour créer une stabilité du droit et renforcer la crédibilité de la Cour » rappelait le professeur Stephen Wermiel sur SCOTUSBlog.
En conclusion, comment interpréter, par exemple, les propos du juge Neil Gorsuch lorsque ce dernier affirme que « [l]a Constitution prévoit que les législatures des États — et non les juges fédéraux, les juges des États, les gouverneurs des États et les autres fonctionnaires des États — sont les premiers responsables de l’établissement des règles électorales » (DNC v. Wisconsin State Legislature) ? Cette phrase, exhumée tant par la professeure Shapiro que par Ian Millhiser pour Vox, a été interprétée comme traduisant une forme d’adhésion à l’ISLT. Au regard des éléments précités, il conviendrait de nuancer ces propos en se focalisant sur le terme « établissement » (setting, en anglais). Ce qui a été reproché par les juges conservateurs de la Cour suprême n’est pas tant l’exercice du contrôle juridictionnel par les cours étatiques que l’élaboration de règles électorales : une extension de 3 jours du délai légal pour le retour des bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie, 6 jours en Wisconsin ou encore, dans le cas présent, la création d’une carte électorale. La violation de l’Elections Clause ne paraît donc pas avoir été appréciée à l’aune du simple exercice de contrôle juridictionnel.
Nul ne sait comment les juges répondront à la question qui leur est posée dans Moore v. Harper. Il est peu probable que la majorité soutienne qu’une disposition constitutionnelle garantissant une « élection juste » puisse être interprétée de manière à élaborer des règles électorales. Il est cependant tout aussi peu probable que ladite majorité consente à donner du crédit à cette trop peu sérieuse Independent State Legislature Theory.
À lire :
— The Independent State Legislature Theory, Federal Courts, and State Law, Carolyn Shapiro
— The Independent State Legislature Doctrine, Federal Elections, and State Constitutions, Michael Morley
— Brief in Amici Curiæ in Support of Respondent, Akhil Reed Amar, Vikram David Amar and Steven G. Calabresi
— Rucho v. Common Cause, 588 US__ (2019)